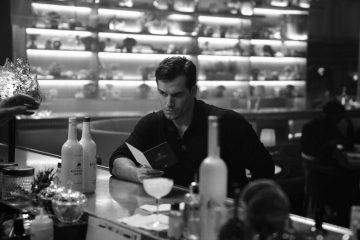=75&strip=all&w=1200″>
Qui sont les prochaines icônes des années 1980 à redécouvrir comme Kate Bush, Metallica et The Cramps via une synchronisation musicale de série génératrice de mèmes ? Mon vote est pour Depeche Mode, cependant, comme Metallica, ils ne sont jamais vraiment partis. Il semble que leur influence soit partout, de l’emo à l’EDM. Leur capacité à passer de couplets mopey à de gigantesques refrains pop, leurs textures de synthétiseur palpitantes, leur capacité à intégrer les influences post-punk britanniques dans le courant dominant américain, voire leur style personnel métrosexuel, semblent aussi actuels que la dernière tendance TikTok.
Le documentaire de concert de 1989 Depeche Mode 101 capture le groupe au moment de sa percée. Le titre fait allusion à la 101e et dernière représentation de la tournée Music For The Masses du groupe, qui les a vus jouer devant plus de 60 000 fans dévoués au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Encore une fois, comme Metallica, ils avaient été considérés comme un acte underground marginal jusqu’à ce moment-là. Ils ne sortiraient jamais un album qui n’a pas fait ses débuts dans le top 10 américain et britannique dans son sillage. Récemment restauré, le film est actuellement diffusé sur Showtime.
Depeche Mode aurait pu facilement suivre les traces de Rattle and Hum de U2 et embaucher un jeune réalisateur de vidéoclips branché pour créer un film glamour film-concert les présentant comme des demi-dieux musicaux. Au lieu de cela, le documentariste légendaire engagé D.A. Pennebaker, dont l’histoire remonte à des films pionniers tels que Don’t Look Back (1967) et Monterey Pop (1968) de Bob Dylan. Le seul glamour retrouvé, c’est quand Depeche Mode est sur scène. Le reste du temps, Pennebaker jette un regard sobre sur le marasme de la vie de tournée et les exploits banals d’un groupe d’adolescents gagnants du concours qui suivent le groupe à travers le pays jusqu’à leur dernière étape à L.A.
Bien que des hitmakers réguliers dans leur Royaume-Uni natal, Depeche Mode n’avait pas eu beaucoup d’impact sur les charts américains avant Music for The Masses en 1987. Ils ont peut-être joué de la pop électronique de pointe à l’âge d’or de MTV, mais ils ont construit une clientèle dévouée aux États-Unis comme tout groupe de rock qui se respecte, en organisant un spectacle en direct et en faisant la tournée de leurs petits culs anglais. Dansant pour abandonner tout en chantant de tout son cœur, Dave Gahan était l’un des meilleurs chanteurs de l’époque et malgré la musique qui aurait pu facilement être préprogrammée, les camarades du groupe Martin Gore, Andy Fletcher et Alan Wilder jouent presque tout en direct sur des racks de claviers. , synthétiseurs et batterie électronique.
Dans des interviews informelles, le groupe nous dit qu’en dehors de leurs bases de puissance côtières, où ils attirent régulièrement entre 10 et 15 000 personnes, ils jouent toujours devant des foules aussi petites que 2 000 dans des avant-postes comme Nashville. En visite dans la capitale de la musique country, ils se rendent dans un magasin de guitares, Gore jouant un groove bluesy convaincant sur un Rickenbacker vintage, et achètent des piles de cassettes country et rockabilly old school. Entre les arrêts de la tournée, ils subissent des contrôles sonores fastidieux, des DJ radio désemparés et des interviews condescendantes, un journaliste obtenant une histoire plus vraie qu’il ne l’avait imaginé en interrogeant Gahan sur sa dernière bagarre.
Après le groupe se trouve un groupe de fans de Long Island qui ont gagné des places dans un bus de tournée grâce à un concours sur la station de radio rock alternative locale WDRE. Tandis que les ploucs au milieu de l’Amérique se moquent de leurs coupes de cheveux amusantes, les enfants dans le bus semblent tout aussi ignorants de la vie de quiconque en dehors de leur bulle de banlieue. Outre les disputes occasionnelles, peu d’intérêt arrive aux enfants du bus dont l’idée d’un bon moment est de boire de la bière jusqu’à ce qu’ils vomissent.
En arrivant au Rose Bowl, Depeche Mode apprend que son émission doit se terminer une heure plus tôt. Dans les coulisses, le groupe s’inquiète entre les plaisanteries sur les chansons et ce qui sera leur plus grand concert aux États-Unis à ce jour. Dans une autre bande-annonce, leurs managers se chamaillent sur la somme d’argent à payer au site pour les dommages causés au gazon et s’émerveillent de l’argent qu’ils ont gagné entre la vente des billets et celle de la marchandise. Après le spectacle, Gahan parle de la déception qui suit la fin de la tournée, qui, même dans sa forme la plus banale, est préférable à l’ennui qui l’attend à la maison.
Au panthéon des documentaires rock, Depeche Mode 101 devrait occuper une place plus importante. Il présente des séquences de performances impressionnantes, un document convaincant et réaliste de la vie quotidienne de la tournée et présage du monde réel et de sa progéniture dans sa représentation des «enfants du bus». Il capture également parfaitement l’Amérique en 1988, avant que l’avènement de la technologie des ordinateurs portables et l’intégration de la culture underground ne bouleversent tout. C’est comme une carte postale d’un monde qui semble complètement différent même si ses échos sont familiers.
Benjamin H. Smith est un écrivain, producteur et musicien basé à New York. Suivez-le sur Twitter : @BHSmithNYC.